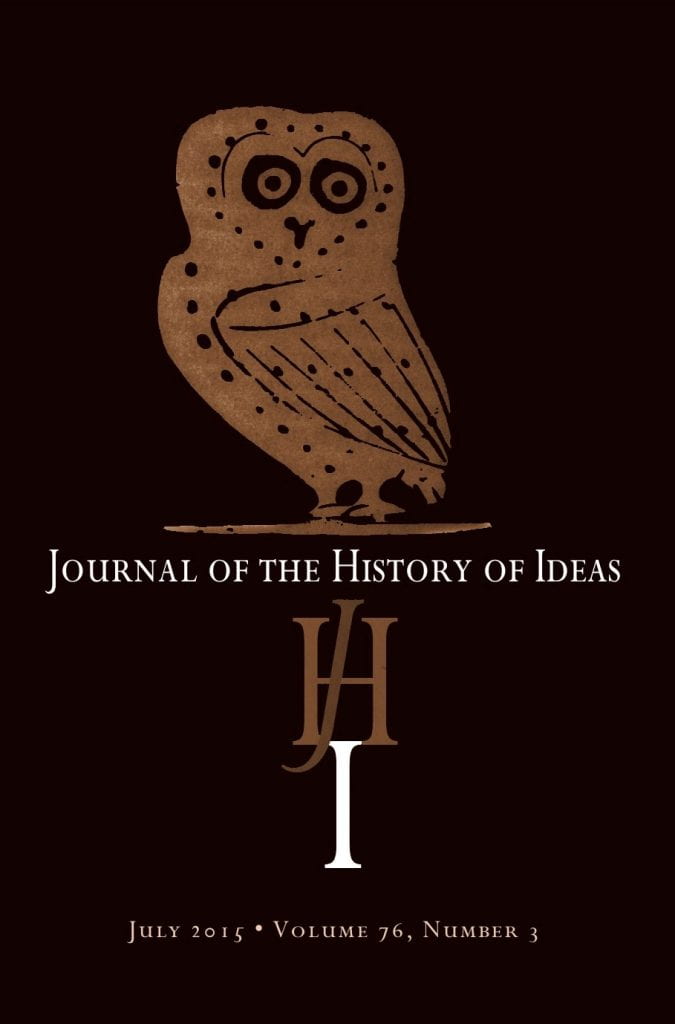En Avril 2019, Arthur Goldhammer a prononcé ce discours aux étudiants de l’Université de Chicago. Nous sommes reconnaissants de sa permission de publier ses remarques dans notre forum sur les l’Université et la démocratie. Cet entretien a été traduit par Justin Saint-Loubert-Bié.
« Qui suis-je et pourquoi suis-je ici? » Vous êtes tous trop jeunes pour vous souvenir de la campagne présidentielle de 1992, où un amiral retraité, James Stockdale, s’est preśenté de cette manière à l’ouverture du débat vice-présidentiel. L’Amiral Stockdale avait l’air de ne pas trop savoir comment il avait fini derrière ce podium, dans une situation pour laquelle il ne semblait pas du tout préparé. Je me trouve dans un pareil embarras. Mais il existe pourtant une réponse simple à cette question : votre doyen a pensé qu’il vous serait utile d’écouter quelqu’un qui a traversé le « mur de Berlin » qui divise les STEM [Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques] et les Lettres. J’ai débuté comme physicien et mathématicien, mais j’ai fini comme traducteur et auteur, ainsi qu’amateur de politique française et européenne.
Autrefois, le mot STEM n’existait pas, alors qu’on ne faisait aucun doute de l’existence d’un « mur de Berlin » entre les disciplines. Aujourd’hui, au contraire, il n’y a plus de mur, mais pourtant il faut un certain courage pour se passer de l’apparente sécurité économique que l’on a dans les disciplines STEM. Au cours de ma présentation, je vais essayer de rapprocher mes propres expériences aux forces qui ont transformé le paysage intellectuel et culturel américain il y a cinquante ans, et qui peuvent, je crois, nous aider à comprendre la polarisation extrême qui menace notre démocratie aujourd’hui. Si vous ne saisissez pas immédiatement la connection entre les problèmes de la démocratie contemporaine et ce que le scientifique, devenu écrivain, C. P. Snow appelait « les deux cultures » – c’est-à-dire, les sciences et le reste – veuillez patienter.
Cette présentation s’intitule « Démocratie dans la rues, démocratie en danger ». J’espère que ce n’est pas trop mélodramatique. Le titre fait référence à deux moments turbulents dans l’histoire moderne américaine. Le premier c’est produit quand j’atteignais la majorité, c’est-à-dire pendant les années 1960, et le deuxième se déroule en ce moment, alors que vous atteignez la majorité. Je voudrais expliquer notre trajet depuis ce premier moment jusqu’au second, en utilisant ma vie en exemple.
Au cours de ma vie professionnelle, j’ai traduit à peu près 120 livres français, dont les plus connus sont les œuvres d’Alexis de Tocqueville et de Thomas Piketty. Vous ne serez donc pas surpris si je vais parler de l’égalité et de l’inégalité aux États-Unis. Ce qu’on trouve de remarquable en comparant ces deux auteurs, c’est que leurs perspectives sur les États-Unis sont radicalement différentes. Tocqueville voyait partout ce qu’il appelait « l’égalité des conditions ». Pour Piketty, ce qu’il y a d’exceptionnel aux États-Unis, c’est les inégalités de revenus et de richesses, qui depuis les trente dernières années ont atteint un niveau aussi élevé que la période juste avant la Première Guerre mondiale. En examinant ma propre vie, j’étais étonné de découvrir à quel point les thèmes d’égalité et d’inégalité s’enchevêtraient avec mon parcours. Donc nous allons revenir beaucoup sur ces thèmes dans ce qui va suivre.
*
Les États-Unis sont en même temps une société égalitaire, peut-être la société la plus égalitaire que le monde ait jamais connu, et une société extrêmement inégalitaire, divisée par la race et la classe sociale, où les revenus et la richesse sont distribués de manière très inégale, où la mobilité sociale est beaucoup plus limitée que le pensent beaucoup d’américains, et où la hiérarchie est très marquée dans la société, la culture, et l’éducation, malgré des efforts périodiques pour remettre la balance à zéro. De plus, alors que l’éducation est souvent proposée comme le meilleur moyen de réduire les inégalités, notre système éducatif est en fait devenu un outil puissant pour les renforcer.
J’aborderai également la manière dont les grands événements et courants historiques – guerres, transformations économiques et démonstrations populaires – influencent les décisions que nous considérons comme privées et personnelles, mais qui peuvent être analysées comme des produits sociaux. Pourtant, ce sont ces décisions mêmes qui constituent notre identité. Nous sommes libres de choisir notre propre parcours dans la vie, puisqu’il n’y a pas de restrictions légales sur ce que nous pouvons devenir : contrairement à, par exemple, la France avant la Révolution, où le statut des parents pouvait interdire aux enfants l’accès à certaines professions. L’absence de ces restrictions était ce que Tocqueville entendait par « l’égalité des conditions ». Mais nous exerçons notre liberté aujourd’hui dans un réseau de contraintes sociales que nous ignorons en grande partie. Dû à mon âge avancé, je contemple mon parcours et je vois émerger ces anciennes routes, tout comme les historiens géographes peuvent voir, grâce aux photographies aériennes, les vestiges d’anciennes routes romaines qui sillonnent les terres agricoles françaises du XXIe siècle.
Les chemins que j’ai suivis n’étaient pas simplement des sentiers imprimés dans le paysage intellectuel par le passage accidentel de ce qui m’a précédé. Mon itinéraire a été soigneusement conçu par des véritables cartographes de l’élite américaine, qui ont tracé un chemin efficace à travers un territoire vierge. Ils ont guidé mon parcours vers les rangs d’une nouvelle génération d’élite où je devais un jour prendre ma place, alors que de base, je n’appartenais à aucune élite. Un autre titre pour ce qui suit pourrait donc être un « conte de deux élites ».
Au début, il y avait l’élite vivant aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a façonné son développement au cours des trois décennies qui ont suivi, jusqu’à la fin de la guerre du Vietnam. Cette élite a reconnu que sa base de recrutement était tellement restreinte que son exclusivité menaçait le progrès et la prospérité. Elle a donc imaginé des moyens pour ouvrir plus largement les portes des universités les plus prestigieuses du pays.
L’élite qui l’a succédée, atteignant la majorité dans les années 1960, s’est d’abord heurtée à ses aînés, avant de les supplanter. Mais malgré l’orientation « anti-système » [anti-establishment] de cette rébellion générationnelle, les rebelles sont devenus les principaux bénéficiaires des réformes instituées par leurs prédécesseurs. Ces réformes n’avaient pas pour but d’éliminer les inégalités mais de les atténuer. Leur effet, cependant, a été de créer une nouvelle forme d’inégalité : l’inégalité des chances et des privilèges éducatifs.
Ma propre histoire en est un exemple. L’Amérique que j’ai connue en grandissant était celle d’Eisenhower, une époque que nous considérons maintenant comme un moment de calme et de consensus, à cause de la polarisation et de l’esprit partisan que nous vivons aujourd’hui. C’est un mythe, mais c’est l’un de ces mythes de l’âge d’or qui ont une forte emprise sur l’imagination, précisément parce que leur falsification de la réalité exprime un profond désir inconscient. Beaucoup de ceux qui ont répondu à l’appel de Donald Trump de Make America Great Again se sont en fait appuyés sur ce mythe collectif, croyant (erronément) que cette époque était paradisiaque et que des bouleversements sociaux l’ont détruite par la suite.
Mais d’une certaine manière, c’était une époque paradisiaque – les mythes tirent leur pouvoir d’un certain élément de vérité. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons connu une période de croissance exceptionnelle et, par conséquent, d’opportunités exceptionnelles. Le nombre d’Américains qui pouvaient posséder leur propre maison, comme celle où j’ai atteint la majorité, avec son garage pour une voiture sur son terrain standard de 20 mètres par 30, était historique.
Comme le suggère les dimensions de notre habitation, je suis sorti du milieu de cette classe moyenne qui définissait la société toute entière. À l’époque, l’économiste Simon Kuznets pensait que cette nouvelle classe moyenne était la conséquence logique d’une économie de plus en plus complexe, nécessitant un nombre croissant de professionnels et de techniciens instruits pour gérer ses opérations de plus en plus compliquées. Entre 1951 et 1961, le nombre d’étudiants universitaires aux États-Unis a doublé. Dans le nouvel état industriel, comme l’appelait J.K. Galbraith, la gestion serait séparée de la propriété et confiée à une « technostructure » animée par des personnes éduquées ; le pouvoir serait ainsi séparé de la richesse, dépersonnalisé, bureaucratisé, diffusé, et ainsi domestiqué. En théorie.
*
Pour les hommes clairvoyants, les forces qui transformeraient l’économie et la société américaines dans l’après-guerre étaient déjà apparentes, bien avant que leurs conséquences ne deviennent visibles pour tout le monde. Un de ces hommes était James Bryant Conant, né en 1893. Sa naissance a précédé la mienne par peu plus d’un demi-siècle, tout comme la mienne, en 1946, précède la vôtre par la même longueur de temps. Sa carrière, comme la mienne, a brusquement changé de direction, depuis les sciences jusqu’à la non-science, au début de sa vie professionnelle. Mais, contrairement à moi-même, ce qu’il fit avec la deuxième partie de sa vie affecta tous les citoyens des États-Unis.
Conant était clairvoyant parce qu’il a compris tôt comment les sciences et la technologie transformaient l’économie et la société. Au moment même où il obtenait son diplôme de Harvard en 1913, il avait déjà détecté, d’après son biographe, « le parfum alléchant de l’amour qui se développait entre la chimie et l’industrie américaines ». Il aurait pu gagner un prix Nobel par la suite s’il n’avait pas abandonné la chimie pour prendre la charge de Harvard, dont il devint président en 1933.
Pourquoi la Harvard Corporation a-t-elle choisi Conant, et pourquoi Conant a-t-il abandonné les sciences pour la gestion, d’abord de Harvard, ensuite des vastes recherches américaines pendant la Seconde Guerre mondiale? Les sciences et la technologie ne dominaient pas alors les meilleures universités américaines comme elles le font maintenant. Mais les dirigeants de Harvard pensaient que si l’université ne prenait pas en compte les changements au sein de l’économie et de la société, comme elle l’avait fait sous le prédécesseur de Conant, A. Lawrence Lowell, elle perdrait sa place privilégiée parmi les rangs de la société américaine. Conant a été choisi parce qu’il comprenait les avantages du recrutement au-delà des écoles privées et des clubs de l’élite bourgeoise protestante.
James Conant, chimiste et président de Harvard.
La porte devait être ouverte. Pas trop, remarquez : les quotas sur les Juifs, par exemple, ont été augmentés et cachés plutôt qu’effacés. Les réformateurs, après tout, étaient des hommes prudents et conservateurs, pas des révolutionnaires, même si Conant écrivit par la suite un article intitulé « Radical américain » dans lequel il se plaignait que l’Amérique d’avant la Seconde Guerre mondiale était devenue une société de caste, où la richesse héritée dominait la mobilité sociale – qui devait être transformée par un impôt confiscatoire sur les héritages.
Pour un président de Harvard, une institution qui s’appuyait beaucoup sur de riches donateurs, c’était une interprétation assez surprenante des maux qui affligeaient l’Amérique. Ned Lamont, banquier et membre de la Harvard Corporation, n’a pas tardé à le rappeler à Conant dans une lettre de réprimande précipitée par la publication de « Radical américain ». En vérité, Lamont n’avait pas à s’inquiéter. Conant ne prenait pas tout à fait au sérieux son idée, qu’il n’avait par ailleurs aucun pouvoir de la mettre en place. Sa proposition vraiment révolutionnaire était en fait de changer la façon dont les meilleures universités américaines sélectionnaient leurs étudiants – en fin de compte une attaque beaucoup plus radicale, mais moins frontale, contre l’ordre établi que de taxer les riches. Et cette promesse-là, il pouvait réellement la tenir.
Malgré son côté radical, ce programme de réforme visait l’efficacité, et non pas l’égalité. Le président de Harvard n’avait rien contre la domination d’une élite ; mais il méprisait l’élite contemporaine, qu’il jugeait complaisante, sans imagination et mal adaptée aux besoins de la nouvelle économie. Dans l’histoire de l’éducation américaine, il y a toujours eu une tension entre ceux qui estiment que la préservation de la démocratie demande qu’un maximum de personnes aient accès à l’éducation, et ceux qui pensent que la société peut optimiser les bénéfices offerts par ses dépenses éducatives, en prodiguant le plus de ressources possible sur ceux qui sont les mieux équipés pour en profiter. Conant appartenait à ce deuxième camp, croyant qu’un barrage de tests était le meilleur moyen de sélectionner la future élite du pays, qu’il envisageait, en empruntant les mots de Thomas Jefferson, comme une « aristocratie naturelle » – naturelle par opposition à héréditaire.
L’élite devait être élargie, selon Conant, afin d’exploiter les talents scientifiques qui se cachaient dans des groupes auparavant exclus. Cette conviction a été renforcée par son rôle dans la Deuxième Guerre mondiale, au cours de laquelle, en tant que président du Comité de recherche sur la défense nationale, il coordonnait les travaux sur la bombe atomique. Les Juifs nés aux États-Unis comme Robert Oppenheimer et Richard Feynman avaient joué un rôle décisif dans la construction de l’arme ultime et donc de la clé qui ouvrait aux États-Unis la domination mondiale ; des immigrants comme l’Allemand Hans Bethe et l’Italien Enrico Fermi et les Hongrois Eugene Wigner et Edward Teller les avaient rejoints. Combien d’autres étudiants comme eux se cachaient dans les écoles publiques américaines, loin de Groton et Lawrenceville et donc peu susceptibles de finir à Harvard ou Princeton ? Pour les trouver, Conant, qui, en tant que président de Harvard, et jouissant d’un prestige énorme grâce à son rôle décisif pendant la Deuxième Guerre mondiale, était en mesure de remodeler l’éducation américaine, s’est tourné vers le SAT [Teste d’aptitude scolaire]. Grâce à ce test et à d’autres instruments similaires, les étoiles enveloppées par la brume impénétrable de l’éducation publique américaine pourraient enfin être détectées et développées.
*
Le tri et la sélection en gros des talents intellectuels par des tests standardisés étaient encore en train d’être perfectionnés lorsque j’ai commencé la maternelle en 1951, et j’en devint un cobaye et bénéficiaire précoce. En CP, j’ai été convoqué au bureau du directeur, où un psychologue m’a administré un test de QI, après quoi les autorités scolaires ont informé mes parents qu’ils souhaitaient me déplacer dans une classe supérieure. De peur que je sois ostracisé socialement, mes parents ont refusé.
Mais le sort en était jeté. L’établissement éducatif m’a bien fait comprendre que j’étais parmi les élus. Non seulement je réussissais aux tests, mais en plus, je faisais preuve d’une capacité exceptionnelle dans les domaines que les réformateurs comme James Conant jugeaient particulièrement importants pour l’avenir économique et géopolitique des États-Unis.
La guerre avait donné aux sciences physique un prestige énorme. Albert Einstein mourut quand j’avais huit ans. Le magazine Life, auquel mes parents étaient abonnés, publia un portrait hagiographique de cet « intellect pur » qui, sans autre outil que les mathématiques, avait changé le cours de l’histoire. Quel jeune scientifique ne voudrait pas se tenir sur les épaules d’un tel géant ? À dix ans, les Russes lancèrent Spoutnik, le premier satellite en orbite autour de la terre. Le monde vit que les Soviétiques non seulement avaient la bombe atomique mais nous avaient aussi devancés dans le développement de la fusée nécessaire pour la lancer. Produire davantage de scientifiques et d’ingénieurs devint un projet national.
L’année suivante, à onze ans, le Congrès adopta la National Defense Education Act [Loi sur l’éducation pour la défense nationale], qui offrit dès lors des fonds fédéraux au projet du recrutement de scientifiques. De mon côté, je construisais déjà des émetteurs et récepteurs radio à ondes courtes, et le jour de mon treizième anniversaire, l’âge minimum, je suis devenu le plus jeune américain à obtenir une licence de radio amateur de classe générale. J’étais exactement le genre d’étoile cachée que Conant jugeait nécessaire pour le futur des États-Unis : un talent scientifique précoce, dont les parents n’avaient pas obtenu leur diplôme universitaire, mais qui, grâce à de nouveaux tests psychométriques, pouvait être identifié tôt et mis sur la voie du succès.
Mon lycée, qui séparait selon leur capacités la majorité des élèves en trois groupes, étiquetés de manière énigmatique – W, X et Y – réserva une quatrième piste à une poignée d’élèves qui avaient apparemment fait preuve d’un potentiel particulier. Contrairement aux autres, ce groupe était simplement appelé « spécial ».
Être « spécial » offrait des avantages considérables. C’était presque comme recevoir une éducation privée aux frais du gouvernement. Nous étions une vingtaine, sur une cohorte totale d’un peu moins de 500. Ceux qui nous ont sélectionnés auraient été satisfaits des résultats. Ce groupe de vingt a produit au moins cinq doctorats. Parmi nous, il y avait de futurs professeurs, scientifiques, ingénieurs, médecins, avocats, enseignants, un doyen de Yale, un PDG et un diplomate aux Nations Unies. Les trois principales minorités de notre ville – juive, afro-américaine et italienne – étaient toutes représentées, même si le maire, le conseil municipal et les principaux hommes d’affaires étaient encore largement des protestants anglo-saxons blancs. En bref, ma cohorte a réalisé le rêve de Conant : nous renforçâmes les rangs de l’élite américaine, la revigorant avec du sang frais. Vu d’en bas, cela ressemblait à l’ascension sociale – pas le rêve de Conant, mais le rêve américain. Vu d’en haut, c’était le minimum nécessaire pour faire face aux nouveaux défis économiques, militaires et technologiques.
*
Pourtant, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme l’imaginait Conant, ou comme nous l’avions peut-être vaguement anticipé. Nous pensions que nos motivations étaient respectables, et non pas pécuniaires. Et comme nous répondions à l’appel de la nation, nous ne nous attendions pas à être dénoncés un demi-siècle plus tard par le président Trump, qui nous a décrit dans les termes suivants lors d’un rassemblement de ses partisans en 2017 : « Pourquoi eux c’est l’élite ? J’ai un bien meilleur appartement qu’eux. Je suis plus intelligent qu’eux. Je suis plus riche qu’eux. Je suis devenu président, et pas eux. »
Le président – qui, comme Bill et Hillary Clinton, appartient à la même cohorte du Baby Boom que moi – n’a pas inventé ce sentiment anti-élite, mais, avec un instinct impressionnant, a reconnu son ubiquité et l’a utilisé comme arme contre son adversaire Hillary Clinton, qu’il décrivit comme l’incarnation même du privilège de l’élite. Cette antipathie envers l’élite éduquée était plus qu’une simple réapparition de « l’anti-intellectualisme » au sein de la vie américaine que l’historien Richard Hofstadter avait déjà identifié dans les années 1960. Egghead [tête d’oeuf] et brainiac [intello] étaient des termes d’abus assez courants à l’époque. Mais au cours du demi-siècle qui a suivi, les privilèges accordés aux diplômés des grandes universités sont devenus l’objet, non pas d’une simple dérision, mais d’une haine corrosive et active. Cette hostilité s’est répandue, ciblant non seulement les eggheads authentiques, mais aussi une classe plus large d’individus qui auraient tiré un avantage injuste de l’éducation supérieure. On le voit dans les attaques extraordinairement virulentes contre les présidents Clinton et Obama. Tous deux furent accusés d’avoir vu un succès que leur expérience ne pouvait justifier, distingués uniquement par leur éducation Ivy League.
On critiquait aussi Clinton et Obama pour une autre raison : leurs mariages à des femmes similairement situées. Les deux couples illustrent un phénomène que les économistes appellent « l’accouplement positif assorti » : la tendance croissante des personnes très instruites à multiplier leurs avantages en se mariant entre eux, augmentant l’écart qui les sépare des moins privilégiés, en termes non seulement de revenus mais aussi de ressources culturelles. En effet, un autre produit de la turbulence des années 1960, c’est que les femmes quitteront la rue pour se rendre au travail. La famille, en particulier la famille très éduquée, devint de moins en moins un patriarcat et plus en plus un partenariat, déterminé à garantir à sa progéniture le billet d’entrée à la nouvelle élite.
Le sociologue et écrivain anglais Michael Young inventa le mot « méritocratie », prédisant que plusieurs finiraient par éprouver de la rancune contre les privilèges accordés par la sélection éducative. En 1958, il publia un essai satirique dans lequel il tenta d’imaginer le type de société que Conant était en train de créer, dirigée par une classe d’intellectuels soigneusement choisis. La sélection méritocratique de Conant était sans aucun doute injuste à bien des égards qui ont par la suite été abondamment documentés, mais il était aussi sans doute plus juste que le système qui lui a précédé – du moins à l’origine. Cependant, cette sélection est devenue de moins en moins juste, car l’avantage engendre inévitablement un avantage. Comme Anthony Appiah l’a écrit récemment dans un article sur Young : dans une société avec une élite méritocratique, « presque tous les parents vont essayer d’obtenir des avantages injustes pour leur progéniture ». Michael Young a eu raison de prédire que, peu importe à quel point on essayait de rationaliser le processus de sélection, les privilèges accordés à cette nouvelle élite « méritocratique » seraient un jour remis en cause comme illégitimes.
*
Grâce à l’histoire, nous connaissons bien les révoltes contre le privilège, et le mépris que Trump tient pour l’élite d’aujourd’hui pourrait être interprété comme telle. Mais il cible en partie de nombreuses personnes qui croyaient amener la « démocratie dans la rue » pendant les années 1960, et qui se révoltaient eux-mêmes contre les prérogatives de la génération précédente de l’élite. J’étais parmi eux, et peut-être aussi l’étaient vos parents ou vos grands-parents.
Ce n’est pas ici qu’il faut tenter de résumer l’histoire des années soixante. Pour nous, ce qui est pertinent, c’est la division qui s’est développée à cette époque au sein de, et entre, les deux élites : l’ancienne génération, forgée par la Seconde Guerre mondiale, et la plus jeune, forgée par la Guerre du Vietnam.
En 1965, James Conant, la personne qui a fait le plus pour donner accès aux grandes écoles à des gens comme moi, signe une déclaration en faveur de l’intervention américaine au Vietnam. Pour la génération qui a vu la Seconde Guerre mondiale, la complexité des relations internationales était supplantée par l’idée d’une lutte mondiale entre la liberté et la non-liberté. L’apaisement était l’erreur à éviter à tout prix : c’était la principale leçon qu’ils avaient tiré de l’histoire. Le Sud-Vietnam était le nouveau Sudetenland, le prix convoité par l’ennemi ; il ne pouvait être cédé à la non-liberté.
Ces guerriers intellectuels, endurcis par la guerre totale, s’enorgueillissaient de leur force d’esprit. Considérez, par exemple, comment Conant justifia son travail sur la première arme de destruction massive, le gaz toxique, pendant la Première Guerre mondiale : « Je n’ai pas vu en 1917, et je ne vois pas en 1968, pourquoi déchirer les tripes d’un homme avec un obus est préférable à le mutiler en attaquant ses poumons ou sa peau. » La bombe atomique le força à une réflexion légèrement plus approfondie, mais il finit néanmoins par approuver le bombardement d’Hiroshima et de Nagasaki.
En bref, la conscience morale de cette élite plus âgée avait été formée par une guerre totale et devrait rester consciente de la possibilité d’un anéantissement total par la suite. La nôtre, en revanche, avait été formée par une lutte moins lointaine, le mouvement des droits civiques, qui s’est abattu sur Washington la même année que je partis à l’université. Pour nous, nouveaux membres d’une nouvelle élite, à qui des portes auparavant fermées venaient tout juste d’être ouvertes, il était tout à fait naturel, bien que rétrospectivement égoïste, de voir le mouvement des droits civiques comme une extension de la conscience progressiste du New Deal, que nous créditâmes pour notre propre bonne fortune (en applaudissant trop fort Roosevelt et trop peu Conant, négligeant l’aspect instrumental conservateur de la pensée de ce dernier). Pour nous, tout cela faisait partie d’une poussée continue, presque irrésistible, vers un avenir meilleur, le New Deal qui devenait la Great Society de Lyndon B. Johnson. Notre horizon était donc resplendissant d’espoirs plutôt qu’assombri par la fumée des villes allemandes et japonaises enflammées. Lorsque Martin Luther King dit que l’arc de l’univers devait être plié vers la justice, nous baignions donc dans l’illusion que notre propre ascension serait considérée comme un segment de cet arc courbé et donc incontestablement juste, en continuité avec les progrès à venir. Bref, nous avions oublié l’envie que suscite invariablement le privilège.
Franchement, il y avait beaucoup à envier à ma cohorte de baby-boomers privilégiés. Nous étions aussi habiles avec le calcul hédoniste qu’avec le calcul de Newton. Bien que le romancier Saul Bellow ait appartenu à la génération précédente, son héros Augie March fut notre représentation précoce : « Je suis un Américain, natif de Chicago … et je prends les choses comme je l’ai appris seul, en écriture libre, et je ferai le récit à ma manière : premier à frapper, premier à entrer ; un coup parfois innocent, parfois moins innocent. » Même si nous étions maintenant entrés par cette nouvelle porte et qu’on s’attendait maintenant à ce que nous consacrions toute notre énergie à bien utiliser notre opportunité, nos yeux avaient été ouverts à d’autres choses. Tout comme Conant avait été consterné par le privilège non mérité qu’il avait découvert à Harvard, une grande partie de ce que nous vîmes depuis notre nouveau point de vue légèrement surélevé nous a déçus. Nous nous attendions à plus.
*
Tout ceci m’amène à 1968. Ce fut l’année quand tout a changé pour moi, bien que je n’en fusse à peine conscient à l’époque. De 1946 à 1968, j’avais avancé facilement, comme sur des roulettes. De tels progrès sont possibles quand y a peu de friction entre ses propres désirs et ce à quoi s’attendent les institutions avec lesquelles on interagit. Le système éducatif, poussé par des réformateurs comme Conant, s’était donné pour tâche de former une génération de scientifiques et d’ingénieurs pour assurer l’hégémonie militaire et économique des États-Unis. Puisque je correspondais à tous les critères requis, j’ai été récompensé à l’âge de 21 ans avec un diplôme en mathématiques du MIT, une année d’études supérieures terminée et un bel avenir qui m’attendait.
Puis, quatre événements se sont succédés rapidement, deux d’importance générale et deux d’importance plus personnelles. Premièrement, la tranquillité américaine fut durablement brisée par des émeutes, des assassinats et plus largement un trouble politique général. Toute illusion de consensus fut détruite par la guerre du Vietnam et l’opposition qu’elle engendra. Deuxièmement, une « contre-culture » prodigieusement variée a brusquement modifié la situation simultanément dans de nombreux pays, créant un vortex cosmopolite. Ce vortex m’a déposé en Europe, où j’ai atterri pour la première fois en juin. Ma découverte du Vieux Continent finirait un jour par me faire abandonner les sciences et les mathématiques pour m’orienter vers les Lettres, l’histoire et, plus précisément, tout ce qui est français. Et finalement, comme conséquence involontaire de cette première incursion en Europe, j’ai été conscrit dans l’armée américaine.
La guerre du Vietnam, qui a en même temps changé l’humeur nationale et ma propre trajectoire, était la faute d’erreurs commises par l’élite. On l’a rapidement reconnu. En 1972, David Halberstam publia The Best and the Brightest, où il analysa les hypothèses erronées des élites en tête du gouvernement qui les avaient entraîné dans ce bourbier désastreux.
Comme James Conant, les nouveaux sorciers de la guerre avaient servi dans l’armée pendant la Seconde Guerre mondiale, au moins en tant qu’apprentis. Comme Conant, ils ont reconnu que les sociétés devaient s’adapter aux changements qui se déroulaient au milieu du XXe siècle. McGeorge Bundy, qui avait était le conseiller à la sécurité nationale – d’abord de John Kennedy, ensuite de Lyndon Johnson – avait reçu un poste de direction à Harvard malgré son âge précoce, tout comme Conant. Il avait même été exposé, grâce à son travail sur les aspects à la fois publics et secrets du Plan Marshall, à des projets ambitieux d’ingénierie sociale et politique dans l’Europe d’après-guerre, une extension du type d’ingénierie sociale mis au point par Conant aux États-Unis. Avec d’autres architectes de la guerre du Vietnam, il chercha à appliquer les leçons apprises en Europe au Vietnam, où elles se sont révélées inapplicables.
Une conséquence inattendue du processus pour sélectionner les élites était d’encourager la confiance en soi. Lorsqu’on a bien répondu à tant de questions, on commence à penser qu’on ne peut pas se tromper. Et lorsqu’on est entouré de personnes qui ont donné les mêmes réponses correctes à la même série de questions, le danger que pose la conformité est évident. Certes, les étoiles brillantes de l’élite ont reconnu ce danger et ont trouvé un avocat du diable, George Ball, pour leur exposer les pires scénarios que pourraient produire leurs actions. Ball, qui était plus un historien qu’un ingénieur social, conseilla la prudence, mais en fin de compte fut ignoré, car il aurait fallu un miracle pour que l’avocat du diable remporte la victoire face à une chorale d’anges chantant à l’unisson.
*
Permettez-moi maintenant d’oublier la décision de l’élite concernant le Vietnam pour m’attarder sur ma propre décision. Un de mes collègue qui a lu un brouillon de cette présentation m’a fait remarquer que « cet essai concerne moins votre trajectoire que la trajectoire de la civilisation occidentale. Je pense que vous pourriez traiter un peu plus longuement de vos réflexions sur les décisions qui ont façonné votre vie sans paraître trop autoréférentiel. D’après mon expérience, c’est exactement ce que les jeunes n’entendent pas assez souvent : ils entendent déjà suffisamment de discours sur le sort de la civilisation occidentale. »
En effet. Je vous prie donc de me laisser parler un peu de moi-même. Il n’y avait pas beaucoup de gens comme moi parmi les soldats qui partirent au Vietnam. Alors pourquoi étais-je là, étant donné que je m’opposais à la guerre et que j’avais manifesté contre elle ? J’avais profité volontiers des diverses exemptions qui m’étaient disponibles, en suivant néanmoins ma conscience. C’est-à-dire que je m’appuyais déjà sur mon privilège en tant que membre de l’élite éduquée.
Mais lorsque la commission d’aptitude du Service National choisit de manière plutôt arbitraire de déclarer que mon voyage d’été en Europe entre ma première et ma deuxième année d’études supérieures constituait une « interruption » de mes études, ce qui me rendait éligible à la conscription, j’ai été confronté à un dilemme. Mon appel pour un sursis fut en fait accordé par le Commandant du Selective Service, mais uniquement en tant que recommandation que ma commission d’aptitude choisi d’ignorer.
Ma conscience m’a empêché d’affirmer une croyance en Dieu, aussi bien qu’une objection à toutes les guerres, afin de devenir objecteur de conscience, et j’étais également réticent à recourir au subterfuge habituel : simuler une condition médicale disqualifiante. Je n’ai pas l’intention de critiquer ceux qui ont eu recours à de tels subterfuges : si je devais le faire, je ne suis pas sûr que je ne préférerais pas mentir plutôt que de combattre dans une guerre en laquelle je ne croyais pas. Et pour confondre les choses davantage, je ne pourrais pas honnêtement nier que j’étais aussi un peu curieux, et que j’étais prêt à descendre du train à grande vitesse qui m’emmènerait vers la destination choisie pour moi par le président Conant, juste pour explorer, ne serait-ce que pour un instant, ce que la vie pourrait m’offrir d’autre.
Dans tous les cas, je me suis retrouvé transporté, littéralement du jour au lendemain, depuis une salle de classe au MIT ou je faisais des recherches sur la topologie des variétés différentielles,jusqu’à un terrain de parade militaire en Caroline du Sud ou je me retrouvais faisant des pompes. Un an plus tard, après avoir appris à parler vietnamien, j’atterris à la base aérienne de Bien Hoa pour tomber face à face avec la catastrophe militaire, politique et morale qu’était la guerre du Vietnam. Il était naturel de se demander comment les États-Unis, dont le président de l’époque s’était déclaré réticent à engager des « garçons américains dans une guerre terrestre en Asie », avaient commis une erreur aussi monumentale. Si jamais je voulais comprendre cela, il faudrait que j’aille au-delà de la logique lumineuse des sciences pour m’engager dans les mystères plus obscurs de l’histoire et de la philosophie, de la politique et de l’anthropologie, de la fiction et de la poésie. Rétrospectivement, je peux donc dire que ma vie a commencé à changer de trajectoire le 12 novembre 1968, sur la base de l’armée américaine à Boston, lorsqu’un officier militaire convoqua une centaine de soldats de la région de Boston pour faire un pas en avant qui signifierait notre soumission à la chaîne de commandement militaire. « Si vous ne prenez pas ce pas, ajouta cet officier, vous serez arrêté. »
Je me suis donc retrouvé soldat dans l’armée américaine. Pour mes camarades, j’étais une bizarrerie : « le professeur », comme ils m’appelaient. Ils étaient perplexes. « Tu es censé être intelligent, alors pourquoi es-tu ici ?» m’ont-ils demandé. La question m’a surpris. Je m’attendais à ce qu’on éprouve de la rancune contre moi en tant que membre de cette classe de personnes qui, pour la plupart, ont trouvé des moyens d’éviter le service militaire, ou bien à gagner un certain respect pour avoir renoncé à ce privilège, ne serait-ce que sous la contrainte. En revanche, ce que j’ai trouvé aurait plu à Tocqueville, qui considérait que l’intérêt personnel est le seul élément constant du caractère humain. Pour mes pairs, il n’était pas question de moralité, de savoir si l’on devait obéir à sa conscience ou à la loi, ni de savoir ce que cette conscience devait bien exiger. C’était très simple. Si vous avez l’occasion d’éviter de la douleur, vous la saisissez. Si vous ne le faites pas, c’est que vous n’êtes pas très intelligent.
Ce que je n’ai pas trouvé parmi les hommes avec qui j’ai servi au Vietnam, c’était la question « pourquoi sont-ils l’élite ? » que le candidat Trump a si efficacement mobilisé un demi-siècle plus tard. Pourquoi les gars qui m’ont accepté comme un frère d’armes à l’époque me méprisent-ils maintenant en tant qu’« élitiste libéral » ? Qu’est-ce qui a changé entre-temps ? Souvent, on répond que les États-Unis sont devenus un pays beaucoup plus inégalitaire entre 1970 et 2016, comme l’ont démontré Piketty et bien d’autres. Certes, cela fait partie de l’histoire. Mais je pense qu’il y a aussi un aspect tocquevillien. Laissez-moi expliquer.
*
Trois observations qu’ont faites Tocqueville nous peuvent être utiles pour comprendre la polarisation qui déchire de plus en plus la société américaine depuis ces dernières années. Premièrement, il note que le privilège est plus facilement toléré quand on trouve qu’il est utile. Lorsque l’aristocratie de l’ancien régime remplissait des fonctions gouvernementales essentielles, elle était tolérée ; lorsqu’elle céda ces fonctions à la bureaucratie royale et se laissa entraîner à jouir de ses privilèges à Versailles, elle cessa d’être respectée. Je pense que les réformes de Conant ont d’abord été tolérées parce qu’elles répondaient à un besoin largement apprécié. Mais après un certain temps, trop d’étudiants ont commencé à convoiter le billet d’entrée à l’élite non pas pour les connaissances qu’il leur permettrait d’acquérir, mais uniquement comme un instrument qui leur permettrait d’entrer dans un cercle enchanté, avec un avancement professionnel relativement stable et prévisible et où le statut de chacun est relativement à l’abri des aléas de l’économie mondiale. Simplement, les mêmes gens qui ont compris pourquoi les spécialistes des fusées étaient nécessaires pour faire face aux Russes en 1958 ne sont pas prêts à accorder une pareille indulgence aux magiciens des mathématiques qui se sont enrichis en appliquant le calcul stochastique aux produits dérivés financiers qui ont précipité la crise financière de 2008.
Deuxièmement, l’amertume explose lorsque l’attente d’une amélioration imminente est déçue. Selon Tocqueville : « Ce n’est pas toujours en allant de mal en pis que l’on tombe en révolution. Il arrive le plus souvent qu’un peuple qui avait supporté sans se plaindre, et comme s’il ne les sentait pas, les lois les plus accablantes, les rejette violemment dès que le poids s’en allège. » L’accès aux grandes écoles s’est élargi pendant les années 1960, suscitant l’espoir qu’il continuerait de s’étendre au cours des décennies suivantes. Perversement, le fait qu’un segment plus large de la population ait accès à ces écoles n’a fait qu’augmenter la compétition pour des places dont le nombre n’a pas augmenté aussi rapidement que le désir de les occuper.
Et troisièmement, l’espoir sait patienter, mais pas pour toujours. Lorsque Tocqueville parlait de l’intérêt personnel, il aimait ajouter l’expression « bien compris ». Une bonne compréhension, pour Tocqueville, c’était apprendre à concevoir son intérêt personnel à long terme plutôt qu’à court terme. Une personne qui concourt pour un prix et ne l’obtient pas peut espérer que ses enfants auront plus de chance, mais si entre-temps les règles du jeu changent de manière à désavantager sa progéniture, la déception passée peut se transformer en amertume, et à un refus de continuer à jouer, car le jeu est perçu comme étant truqué.
Mais je ne vous ai toujours pas raconté comment j’ai fait la transition entre les mathématiques et les Lettres. La vérité, c’est que j’ai exagéré à quel point j’étais l’enfant idéal pour James Conant. Je ne suis jamais resté aussi près de la piste soigneusement préparée que j’aurais dû. J’avais toujours beaucoup lu et j’avais des intérêts très divers, parmi lesquels figurait la fiction française, à commencer par Balzac, que j’ai lu au lycée, puis Stendhal et surtout Proust, parmi tant d’autres. Les sciences étaient, on pourrait dire, ma passion publique, mais le roman français était l’une de mes passions privées. Les ordinateurs du Pentagone me considéraient donc comme soldat francophone, et l’armée avait décidé qu’elle avait besoin de plus de linguistes vietnamiens. À l’époque, les ordinateurs étant plutôt simples d’esprit, ils ont conclu que, puisque le français est une langue étrangère et le vietnamien en est une aussi, avoir appris l’une devrait faciliter la connaissance de l’autre. En plus de cela, je pouvais jouer un instrument de musique, et le vietnamien est une langue tonale. Je suis tout à fait sûr que l’algorithme qui m’a confié la spécialité professionnelle militaire 94L, « linguiste », a été écrit par un jeune et brillant mathématicien très semblable à celui que j’avais été jusqu’à ce que j’entre dans l’armée.
Alors même si je me suis soumis au service militaire, qui, je pensais, avait retiré mes privilèges et m’avait mis sur le même pied que toutes les autres nouvelles recrues, on m’a brusquement rappelé que peu importe où nous allions, nous sommes constamment triés, classées et sélectionnées par des institutions et des organisations, qui ont chacune leur propre but. Les talents que je considérais comme assez éloignés de mon chemin principal se sont avérés plus importants que je n’aurais pu l’imaginer. L’inégalité est incontournable, la chance l’est encore plus.
Cette classification algorithmique a lancé une longue réflexion sur mes choix. Mon bref voyage en Europe juste avant d’être mobilisé m’avait déjà donné une envie de vivre à l’étranger. Mon choc face à la destructivité irrationnelle et insouciante de la guerre m’a donné l’envie de me plonger plus profondément dans l’histoire et la politique. Et pendant mon service militaire, j’ai été exposé à des segment de l’humanité que je n’avais jamais rencontré dans mes classes « spéciales » de lycée ou au MIT, et qui m’ont fait entendre que si je voulais vraiment poursuivre une autre de mes passions secrètes, écrire de la fiction, j’aurais besoin de vivre des expériences plus diverses et de découvrir beaucoup de choses que je n’avais à peine examinées auparavant, malgré mon penchant studieux.
Pourtant, la triste vérité c’est que, même si je me suis libéré du chemin que James Conant m’avait tracé, j’avais néanmoins une grande dette envers le système d’accréditation qu’il avait perfectionné. Sans ce doctorat d’élite, ma réinvention dans la vingtaine et la trentaine aurait échoué. Le diplôme que j’ai finalement obtenu en 1975 a certifié ma compétence en tant que topologue algébrique, mais depuis lors, il a plus souvent été lu simplement comme la preuve que j’étais un « gars intelligent » – et être pris pour un gars intelligent, même sous de faux prétextes, ouvre bien des portes.
La spécialisation précoce, la conséquence inattendue mais courante de la méthode que nous utilisons pour sélectionner et développer les talents intellectuels, tend à limiter nos perspectives. Une concurrence intense pour un nombre minuscule de grandes écoles impose une attitude implacable, excessivement focalisée et entièrement dédiée aux résultats. Cela ne m’a jamais bien plu. Avant, les Français avaient l’habitude de promouvoir un idéal élitiste assez différent de l’idéal américain, celui de la culture générale, qui a été définie comme « ne savoir presque rien à propos de presque tout ». Comme mon doctorat m’a contraint de m’attarder sur presque tout ce qu’il y avait à savoir sur un presque rien, je me sentais de plus en plus basculer vers cet idéal français. J’ai terminé mon doctorat, puis j’ai enseigné pendant deux ans pour économiser suffisamment d’argent, avant de déménager en France où je me suis mis à écrire un roman au lieu de devenir ce qu’Alfred North Whitehead, qui s’était opposé à ce que James Conant devienne président de Harvard, a appelé un « spécialiste myope. »
Bien sûr, le jugement de Whitehead était injuste, à la fois à propos de Conant, qui s’est avéré être un leader d’une certaine envergure intellectuelle, et à propos des spécialistes, dont la myopie peut conduire à de grandes choses. Personnellement, cependant, la spécialisation ne me convenait pas. J’ai préféré laisser fleurir une centaine de fleurs – enfin une demi-douzaine, peut-être – plutôt que de faire pousser un seul chêne plus impressionnant. Je regrette parfois mon choix. Une fois, dans un moment où je me sentais particulièrement abattu, je me suis qualifié de dilettante superficielle. Un collègue bienveillant m’a dit : « Mais Arthur, tu n’es pas un dilettante. Tu es un génie universel. » Peut-être, mais aux yeux du mathématicien que j’aurais pu être, la meilleure note qu’un génie universel mérite, c’est « peut mieux faire ».
*
Finissons-en avec mon histoire personnelle. Permettez-moi de revenir, pour terminer, sur le thème plus général de la démocratie en danger. Pourquoi tant de gens ressentent-ils ce danger aujourd’hui ? Assiste-t-on à une révolte des masses contre l’arrogance et l’indifférence de l’élite contemporaine, qui prospère aux dépens du plus grand nombre plutôt qu’à leur service ? Ou bien, la multitude maussade a-t-elle été poussée à l’émeute par des démagogues qui les ont convaincus de tenir les élites pour responsables de leur propre lenteur à s’adapter à un monde qui change ? Même dans le meilleur des cas, on ne peut pas s’attendre à ce que les élites soient infaillibles. Parfois, ils refusent d’apprendre les leçons du passé, parfois ils ne les apprennent que trop bien, comme les gens intelligents ont l’habitude de faire, tout en oubliant que le passé n’est plus le présent.
Je n’ai aucune sympathie pour l’anti-élitisme. L’élite sera toujours avec nous, je le crois fermement, et de plus, c’est souvent une bonne chose. Nous avons besoin de personnes capables de résoudre des problèmes que les autres ne savent pas aborder, qui ont une vision à long terme plutôt qu’à court terme, qui essaient de maîtriser l’émotion avec la raison.
Mais nous ne pouvons pas permettre que de simples compétences cognitives, aussi impressionnantes soient-elles, se transforment en privilèges injustes : meilleures opportunités pour ses enfants, meilleur accès aux soins de santé pour soi-même, protection contre la concurrence économique, exemption du service national. Un avantage de mon parcours en zigzag, c’est qu’il m’a donné une double perspective que je trouve utile. J’arrive à voir l’élite depuis l’intérieur ainsi que depuis l’extérieur. Je peux voir les défauts de ses qualités, comme disent les Français, mais aussi les qualités de ses défauts. Cette double vision me donne le courage de vous dire, vous qui êtes sur le point d’accéder aux rangs de l’élite, que vous ne devez ni vous consoler de la conviction que vous méritez les privilèges qui seront bientôt les vôtres, ni être tentés par l’idée que toute hiérarchie ennuyeuse peut simplement être éradiquée.
Tocqueville pensait que la démocratie exige une élite éclairée, mais une élite qui vit parmi, et non pas séparée, du peuple ; une élite qui partage les épreuves des masses, plutôt que de chercher à se retirer dans des communautés fermées et des banlieues bien entretenues, des écoles privées et des restaurants sophistiqués. Le privilège doit être gagné grâce à des sacrifices pour le bien commun plutôt qu’hérité. Sinon, on éprouvera de la rancune contre lui et on le critiquera. La seule élite digne de confiance est celle qui est prête à se soumettre et à accorder ses privilèges à une critique implacable. Et à cette fin, ce serait une bonne chose si quelques-uns des plus brillants prenaient le risque d’essayer de rejoindre les deux cultures que la modernité a divisées. La maîtrise d’un ensemble de connaissances spécialisées encourage une confiance indue, qui doit être tempérée par les idées plus larges, bien que plus vagues, qu’apportent les Lettres. Mais choisir de rester à l’écart, de critiquer depuis l’extérieur plutôt que d’accepter le confort offert à l’intérieur, est un risque. Ce n’est donc pas un choix pour tout le monde. Pourtant, comme ces représentants par excellence de l’élite contemporaine, les analystes quantitatifs, n’hésiteront pas à vous expliquer, sans risque, il n’y a pas de récompense.